Halte aux décharges : naissance de la Fédération Nationale Anti-Décharges (FNAD)
- Par auraenvironnementparis
- Le 26/09/2025
- Dans FNAD (Fédération Nationale Anti-Décharges)
Face à l'inaction de l'Ademe et Géorisques :
un réseau citoyen se mobilise
contre l'enfouissement des déchets !
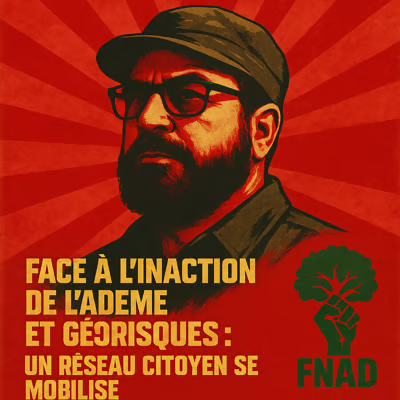
Chaque jour, des milliers de tonnes de déchets ultimes sont enfouies dans des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) aux quatre coins de la France. Ces décharges, présentées comme “contrôlées”, laissent pourtant s’échapper des polluants invisibles : lixiviats contaminés, gaz à effet de serre, dioxines issues des déchets combustibles. Elles saturent les sols, menacent les nappes phréatiques, dégradent l’air et compromettent la santé des riverains.
Nous, collectifs citoyens, associations écologistes, agriculteurs, habitants, lançons aujourd’hui la Fédération Nationale Anti-Décharges (FNAD). Parce que ces sites industriels ne sont pas une fatalité.
Pourquoi les ISDND sont un problème majeur ?
- Pollution de l’eau : les lixiviats contiennent métaux lourds, composés organiques persistants, PFAS.
- Émissions de gaz : méthane, CO₂ et autres gaz à effet de serre contribuent au réchauffement climatique.
- Atteinte à la biodiversité : sols artificialisés, destruction d’habitats, envols de plastiques.
- Santé des riverains : odeurs toxiques, poussières, exposition prolongée à des composés cancérogènes.
Ce que porte la FNAD ?
- Stopper les extensions de décharges et les projets de nouvelles ISDND sous prétexte de “modernisation”.
- Imposer un vrai suivi sanitaire et environnemental, indépendant des exploitants.
- Faire appliquer le principe pollueur-payeur et la réduction à la source.
- Donner la parole aux habitants dans les enquêtes publiques et conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST).
Nos priorités immédiates
- Recenser et cartographier tous les projets de décharges et d’ISDND sur le territoire.
- Informer les citoyens de leurs droits et outils pour agir (recours ICPE, enquêtes publiques, référés).
- Fédérer les luttes locales pour constituer une voix nationale puissante.
La FNAD, c’est la fin de l’isolement. Ensemble, nous pouvons dire non à l’enfouissement et ouvrir la voie à un vrai modèle circulaire et sobre.
En effet, nous déplorons de graves lacunes :
1. Problèmes spécifiques liés à l’enfouissement des déchets en France
- En 2024, 20 % des ordures ménagères en France sont encore enfouies, soit 17 millions de tonnes, loin des objectifs fixés (moins de 10 millions de tonnes d’ici 2025).
- Les sites d’enfouissement (ISDND) sont censés n’accueillir que des déchets ultimes, mais en réalité, des déchets recyclables y sont encore enfouis, notamment à cause d’un tri insuffisant ou d’un manque d’infrastructures adaptées.
- L’enfouissement génère des émissions de méthane, un gaz à fort pouvoir de réchauffement, et des pollutions des sols et des nappes phréatiques.
- Malgré les efforts, la France n’atteint pas ses objectifs de recyclage : seulement 46 % des déchets non minéraux non dangereux étaient recyclés en 2022, contre un objectif de 65 % en 2025.
- Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire, 2020) : elle fixe des objectifs stricts de réduction de l’enfouissement des déchets, notamment en interdisant l’enfouissement des déchets non recyclables à partir de 2025 et en renforçant les obligations de tri et de valorisation :
- Directive européenne 1999/31/CE : Elle impose aux États membres de réduire progressivement l’enfouissement des déchets biodégradables, sous peine de sanctions.
- Code de l’environnement (Art. L. 541-1 et suivants) : Il définit les principes de gestion des déchets, notamment la hiérarchie des modes de traitement (prévention, réemploi, recyclage, valorisation, élimination).
Jurisprudence :
- CE, 19 juillet 2019, n° 415478 : Le Conseil d’État a rappelé que les collectivités locales doivent respecter les objectifs de réduction de l’enfouissement fixés par la loi AGEC, sous peine de sanctions financières ou administratives.
2. Rôle et responsabilités de l’Ademe et Géorisques
- L’Ademe (Agence de la transition écologique) a pour mission d’accompagner la transition vers une économie circulaire, en favorisant le recyclage, la valorisation des déchets et la réduction de l’enfouissement. Elle publie des données, des guides méthodologiques et soutient financièrement des projets de dépollution et de gestion des déchets.
- Géorisques est une plateforme publique qui recense les risques environnementaux, y compris les sites pollués et les anciennes décharges. Elle permet de surveiller et de cartographier les zones à risque, mais ses données ne sont pas toujours à jour, notamment sur l’état actuel des décharges littorales ou des sites réhabilités.
- Les deux organismes sont censés fournir des données fiables et actualisées pour permettre une gestion transparente et efficace des déchets, mais des lacunes persistent, notamment dans la mise à jour des fichiers et des inventaires.
Textes juridiques :
- Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 : Il définit les missions de l’Ademe, notamment en matière de collecte, de traitement et de valorisation des données sur les déchets.
- Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 : Elle impose aux pouvoirs publics de garantir l’accès du public aux informations environnementales, y compris celles détenues par Géorisques.
- Code de l’environnement (Art. L. 124-1 à L. 124-8) : Il encadre la transparence et la mise à disposition des données environnementales.
Jurisprudence :
- CJUE, 16 juillet 2020, C-535/18 : La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que les États membres doivent garantir un accès effectif aux informations environnementales, y compris celles relatives aux sites pollués ou aux décharges.
3. Critiques et controverses
- Les données de l’Ademe et Géorisques sont parfois critiquées pour leur manque de mise à jour, ce qui rend difficile le suivi précis des progrès et des reculs en matière de gestion des déchets.
- Les objectifs de réduction de l’enfouissement ne sont pas atteints, en partie à cause d’un manque de moyens, de retards dans la mise en place des filières de tri et de valorisation, et d’une coordination insuffisante entre les acteurs.
- La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) a été augmentée pour dissuader l’enfouissement, mais son efficacité est limitée par des défaillances dans le tri et la collecte.
Textes juridiques :
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (Loi de transition énergétique) : Elle renforce les obligations de transparence et de reporting pour les acteurs publics et privés en matière de gestion des déchets.
- Règlement (UE) 2018/841 : Il impose aux États membres de publier des rapports annuels sur la gestion des déchets, sous peine de sanctions.
Jurisprudence :
- TA Paris, 12 mars 2021, n° 1904914 : Le Tribunal administratif de Paris a condamné une collectivité locale pour ne pas avoir mis à jour ses données sur les décharges, en violation de l’obligation de transparence prévue par le Code de l’environnement.
4. Initiatives citoyennes en France
- Les actions citoyennes de ramassage de déchets (cleanwalks, opérations de dépollution) se multiplient, mobilisant des milliers de bénévoles chaque année. Par exemple, la plateforme JeVeuxAider.gouv.fr recense des centaines d’opérations de nettoyage organisées par des associations et des particuliers.
- Des réseaux comme le Réseau Compost Citoyen ou des événements comme la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) encouragent la participation active des citoyens à la gestion des déchets, avec des ateliers, des campagnes de sensibilisation et des projets locaux.
- En région, des initiatives comme « Nettoyons le Sud » ou « J’aime la nature propre » fédèrent des milliers de participants pour des opérations de ramassage et de tri, souvent en partenariat avec les collectivités.
Textes juridiques :
- Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (Loi sur l’économie sociale et solidaire) : Elle encourage les initiatives citoyennes et associatives en matière de gestion des déchets, notamment via des subventions ou des partenariats avec les collectivités.
- Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 : Il facilite la création de « zones de compostage citoyen » et encadre les actions de ramassage de déchets organisées par des associations.
Jurisprudence :
- CE, 5 juillet 2018, n° 407456 : Le Conseil d’État a reconnu le droit des associations à organiser des opérations de ramassage de déchets sur le domaine public, sous réserve d’une autorisation préalable de la collectivité concernée.
5. Succès des réseaux citoyens à l’international
- Les réseaux citoyens ont prouvé leur efficacité dans d’autres pays, notamment en Allemagne où la mobilisation locale a permis de réduire drastiquement les déchets enfouis et d’augmenter le recyclage, grâce à une forte implication des habitants et des associations.
- En France, des projets comme la généralisation du compostage de proximité ou la création de filières locales de réemploi montrent que l’engagement citoyen peut combler les lacunes des institutions, à condition d’être soutenu par des politiques publiques adaptées.
Textes juridiques :
- Directive européenne 2008/98/CE : Elle encourage la participation citoyenne à la gestion des déchets, notamment via des projets de réemploi ou de recyclage.
- Loi allemande sur l’économie circulaire (KrWG, 2012) : Elle impose aux collectivités locales de soutenir les initiatives citoyennes de réduction des déchets.
Jurisprudence :
- CJUE, 4 mars 2021, C-323/19 : La Cour a confirmé que les États membres doivent encourager et faciliter les initiatives citoyennes de gestion des déchets, en application du principe de participation du public (Convention d’Aarhus).
6. Lacunes dans les données de l’Ademe et Géorisques
- Les inventaires des anciennes décharges (notamment littorales) datent souvent des années 2000 et ne reflètent pas toujours la situation actuelle, ce qui pose un problème pour la surveillance et la réhabilitation des sites.
- Les rapports de caractérisation des déchets, obligatoires pour les collectivités, ne sont pas toujours transmis ou mis à jour dans les délais, ce qui limite la transparence et l’efficacité des politiques de gestion.
Textes juridiques :
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (Loi CADA) : Elle garantit le droit d’accès aux documents administratifs, y compris les données environnementales détenues par l’Ademe et Géorisques.
- Règlement (UE) 2019/1010 : Il impose aux États membres de publier des données actualisées sur les sites pollués et les décharges.
Jurisprudence :
- CE, 22 février 2019, n° 410345 : Le Conseil d’État a sanctionné l’Ademe pour ne pas avoir mis à jour ses données sur les décharges, en violation de la loi CADA.
7. Études de cas inspirantes :
- En Île-de-France, le Budget participatif écologique a permis de financer des projets citoyens de réduction des déchets, comme la création de jardins partagés ou de systèmes de réemploi, montrant l’impact positif de l’implication locale.
- Dans le Sud, des opérations comme « Nettoyons le Sud » ont permis de collecter 100 tonnes de déchets en une journée, grâce à la mobilisation de 25 000 participants.
Textes juridiques :
- Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (Loi NOTRe) : Elle encourage les collectivités locales à soutenir les projets citoyens de gestion des déchets, notamment via des budgets participatifs.
- Décret n° 2017-506 du 7 avril 2017 : Il encadre les appels à projets citoyens en matière de transition écologique, y compris la gestion des déchets.
Jurisprudence :
- TA Lyon, 8 novembre 2020, n° 1803456 : Le Tribunal administratif de Lyon a validé le financement d’un projet citoyen de compostage par une collectivité locale, au titre de la loi NOTRe.
Un danger silencieux pour la faune domestique et sauvage :
Les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ne touchent pas seulement les humains : elles perturbent profondément les écosystèmes et la santé animale.
Polluants et effets sur la faune
• Lixiviats contaminés : infiltration dans les sols et les nappes → risques pour les troupeaux (bovins, ovins, caprins) via l’abreuvement, contamination des pâturages.
• Biogaz (CH₄, CO₂, H₂S) : émanations irritantes pour les voies respiratoires des animaux d’élevage.
• Envols de plastiques et métaux : ingestion par la faune sauvage (oiseaux, renards, sangliers), occlusions digestives, blessures internes.
• Attraction des rats, mouettes, corbeaux : déséquilibre écologique, risques sanitaires (leptospirose, salmonellose).
La FNAD, c’est la fin de l’isolement. Ensemble, nous pouvons dire non à l’enfouissement et ouvrir la voie à un vrai modèle circulaire et sobre.
Rejoignez le réseau FNAD : partagez vos informations locales, témoignez, signalez un projet de décharge, proposez vos compétences.
Contact : aura-environnement@protonmail.com
Marc-Claude de PORTEBANE
Président d’AURA Environnement
Porte-parole de la FNAD
#FNAD #FédérationNationaleAntiDécharges #StopDécharges #LuttesCitoyennes #ÉcologieMilitante #ZéroDéchet #SantéEnvironnementale #JusticeEnvironnementale ISDND #ISDI #DéchargeSauvage #CentreEnf#enfouissement CSR #PollutionsIndustrielles lixiviats dioxines #RecoursAdministratifs ICPE #CodeEnvironnement #JurisprudenceDéchets
